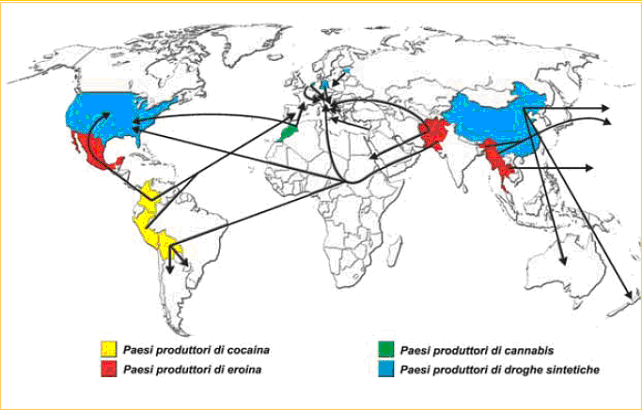
(Crédit image: camera.it)
Dans « Washington et la politique des drogues, » l'enseignant et ancien diplomate canadien Peter Dale Scott explique que ce qu'on appelle la « guerre contre les drogues », des États-Unis doit être comprise au-delà du discours officiel. Il soutient qu'alors qu'on parle de réduire l'offre dans les pays producteurs et la demande dans les villes des États-Unis, des alliances se sont tissées avec des réseaux de trafic de drogue, des armées et des agence du renseignement pour des opérations anti-communistes et contre-insurrectionnelles dans différentes régions du monde.
Scott le résume ainsi : « La connexion protégée entre renseignement et trafic de drogue -ce que j'appelle la symbiose Gouvernement-drogue- a été responsable des plus grands changements dans les schémas et les niveaux du trafic de drogue.»
À partir de ce présupposé, son enquête parcourt les différents scénarios dans lesquels la politique étrangère de Washington, sous le drapeau de la sécurité nationale, s'entrelace avec les intérêts du trafic de drogue. Depuis l'après-guerre européenne jusqu'aux guerres en Asie et en Amérique latine, Scott propose de regarder ces processus comme un phénomène structurel.
Expansion mondiale et complicité de l'État
L'enquête de Scott est centrée sur la façon dont la politique étrangère des États-Unis, sous le drapeau de la sécurité nationale et de la guerre contre les drogues, a fini par renforcer le trafic de drogue lui-même. Pour l'auteur, la véritable faille dans la carte mondiale des drogues est plus venue de la « symbiose Gouvernement-drogue », que des cartels eux-mêmes, dont les services de renseignement et les forces armées ont utilisé les trafiquants et les réseaux criminels comme alliés dans leurs campagnes anti-communistes.
Pendant l'après-guerre, la CIA a soutenu la mafia sicilienne en Italie et la mafia Corse à Marseille, ce qui a renforcé les routes de l'héroïne vers l'Europe et les États-Unis. Ensuite, pendant la guerre du Vietnam, l'épidémie d'héroïne en territoire étasunien s'est répandue et est redescendue au même rythme que la présence militaire dans le sud-est asiatique. Comme le signale Scott,« la connexion protégée entre renseignement et trafic de drogue -ce que j'appelle la symbiose Gouvernement-drogue- a été responsable des plus grands changements dans les schémas et les niveaux du trafic de drogue.»
Ce phénomène a atteint une autre dimension dans les années 80. En 1984,54 % de l'héroïne consommée aux États-Unis, provenait de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dominée par les moudjahidines, alliés de la CIA contre l'occupation soviétique. Le trafic de drogue, constitué une partie structurelle de l'opération : « les mêmes acteurs qui fournissaient l'insurrection déplaçaient la plus grande partie de l'héroïne qui entrait aux États-Unis, » dit le texte.
Parallèlement, en Amérique centrale, au moins un cinquième de la cocaïne qui entrait aux États-Unis, arrivait par le Honduras, où les militaires locaux, liés au trafic de drogue, étaient les pièces centrales du soutien secret de Washington aux Contras nicaraguayennes.
Ce schéma, c'est un Colombier au Pérou ou les alliances avec les forces armées, soi-disant anti drogues, on finit par financer des campagnes anti-insurrectionnelles dans lesquelles les principaux chefs n'étaient pas l'objectif, mais des alliés tactiques. Le cas de Vladimiro Montesinos, au Pérou, en est un bon exemple : chef du service du renseignement national, entraîné par la CIA, il a utilisé des ressources destinées à des opérations contre les drogues pour renforcer les réseaux de pouvoir et la répression intérieure. En 1996, un trafiquant a accusé Montesinos de recevoir des dizaines de milliers de dollars en pots-de-vin tandis que la police péruvienne ne saisissait qu'un seul chargement du cartel Lopez-Paredes avec 3 500 tonnes de cocaïne évaluées à 600 000 000 de dollars.
Il s'est passé la même chose au Mexique où la direction fédérale de la sécurité (DFS), créée avec le soutien des États-Unis, a remis des accréditations officielles à des chefs du trafic de drogue, que la DEA décrivait comme « une licence pour trafiquer. » Le cartel de Guadalajara, protégé par la DFS et son chef Miguel Nassar, Haro -un agent de la CIA- en est venu à être la clé de l'approvisionnement de l'insurrection nicaraguayenne financée par Washington.
Dans tous ces cas, les campagnes contre la drogue ont servi de couverture à des objectifs politiques et militaires, tandis que le trafic de drogue augmentait sous la protection officielle. Finance, politique et réseaux du BCCI.
Le cas de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) est, pour Scott, la preuve la plus claire de la façon dont la « guerre contre les drogues » s'est entrelacée avec des intérêts financiers, militaires et politiques au plus haut niveau. Cette Banque, qui a son siège au Pakistan et fait des opérations dans le monde entier, a été pendant des années un noeud central du blanchiment d'argent du trafic de drogue, de la vente d'armes et du financement d'opérations secrètes en Asie, en Amérique latine et en Asie occidentale.
L'investigation signale que le BCCI gérait les fonds du trafic de drogue afghan pendant la guerre contre l'URSS mais avait aussi des gens avec des Gouvernements alliés de Washington et des réseaux du renseignement comme la CIA et l'ISI pakistanais. Ouvre avec le plein soutien de l'ISI et la tolérance tacite de la CIA, Hekmatyar est devenu le principal trafiquant de drogue d'Afghanistan, » dit Scott à propos de Gulbuddin Hekmatyar, un dirigeant moudjahidin qui est devenu un grand patron de la drogue, renforcé politiquement et militairement grâce à ces structures financières.
Ce qui n'y ce qui signifie que, bien qu'en 1990, deux filiales de la BCCI, aient été déclarées coupables de blanchiment d'argent, et que plusieurs des membre de leur direction aient été emprisonnés, le département de la justice des États-Unis est intervenu pour freiner les enquêtes plus profondes. Entre 1988 et 1991, le département « a sollicité à plusieurs reprises que les actions du Sénat sur la BCCI soient retardées ou paralysées, a refusé de collaborer avec la sous-commission Kerry et, à certaines occasions, a fait des déclarations trompeuses sur l'état des investigations, » écrit l'auteur.
Le scandale a aussi touché des personnalités politiques de haut niveau. La BCCI et ses alliés financiers ont eu des liens avec des Gouvernements et des présidents comme Carter, Reagan, Busch et Clinton à travers des dons et des opérateurs comme le banquier Jackson Stephens.
Une guerre qui n'a jamais eu lieu
La révision des affaires présentées par Scott permet de conclure que la politique contre les drogues des États-Unis a été traversée par de profondes contradictions. Les preuves réunies montrent que les soi-disant efforts globaux contre les drogues ont fonctionné, dans la pratique, comme un instrument destiné à renforcer les intérêts stratégiques plutôt que pour freiner le pouvoir des cartels.
« La mal nommée « guerre contre les drogues », doit être remplacée par une campagne médicale et scientifique destinée à soigner la maladie des drogues, » dis Scott et il signale la distance entre le discours officiel et les résultats obtenus.
Tout cela, soutient la thèse que l'affrontement avec le trafic de drogue n'a jamais été véritable. Ce qui existe, c'est une gestion politique de la violence et du marché illégal dans lequel les alliés et les ennemis se redéfini par rapport au véritable intérêt stratégique. Les politiques des États-Unis renforcent ces réseaux criminels en les rendant plus complexes et résiliants. De cette façon, il est patent que la véritable priorité se situe dans l'instrumentalisation du trafic de drogue pour servir les buts de Washington.
Source: Bolivarinfos.over-blog
L'article original est accessible ici
Dans « Washington et la politique des drogues, » l'enseignant et ancien diplomate canadien Peter Dale Scott explique que ce qu'on appelle la « guerre contre les drogues », des États-Unis doit être comprise au-delà du discours officiel. Il soutient qu'alors qu'on parle de réduire l'offre dans les pays producteurs et la demande dans les villes des États-Unis, des alliances se sont tissées avec des réseaux de trafic de drogue, des armées et des agence du renseignement pour des opérations anti-communistes et contre-insurrectionnelles dans différentes régions du monde.
Scott le résume ainsi : « La connexion protégée entre renseignement et trafic de drogue -ce que j'appelle la symbiose Gouvernement-drogue- a été responsable des plus grands changements dans les schémas et les niveaux du trafic de drogue.»
À partir de ce présupposé, son enquête parcourt les différents scénarios dans lesquels la politique étrangère de Washington, sous le drapeau de la sécurité nationale, s'entrelace avec les intérêts du trafic de drogue. Depuis l'après-guerre européenne jusqu'aux guerres en Asie et en Amérique latine, Scott propose de regarder ces processus comme un phénomène structurel.
Expansion mondiale et complicité de l'État
L'enquête de Scott est centrée sur la façon dont la politique étrangère des États-Unis, sous le drapeau de la sécurité nationale et de la guerre contre les drogues, a fini par renforcer le trafic de drogue lui-même. Pour l'auteur, la véritable faille dans la carte mondiale des drogues est plus venue de la « symbiose Gouvernement-drogue », que des cartels eux-mêmes, dont les services de renseignement et les forces armées ont utilisé les trafiquants et les réseaux criminels comme alliés dans leurs campagnes anti-communistes.
Pendant l'après-guerre, la CIA a soutenu la mafia sicilienne en Italie et la mafia Corse à Marseille, ce qui a renforcé les routes de l'héroïne vers l'Europe et les États-Unis. Ensuite, pendant la guerre du Vietnam, l'épidémie d'héroïne en territoire étasunien s'est répandue et est redescendue au même rythme que la présence militaire dans le sud-est asiatique. Comme le signale Scott,« la connexion protégée entre renseignement et trafic de drogue -ce que j'appelle la symbiose Gouvernement-drogue- a été responsable des plus grands changements dans les schémas et les niveaux du trafic de drogue.»
Ce phénomène a atteint une autre dimension dans les années 80. En 1984,54 % de l'héroïne consommée aux États-Unis, provenait de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dominée par les moudjahidines, alliés de la CIA contre l'occupation soviétique. Le trafic de drogue, constitué une partie structurelle de l'opération : « les mêmes acteurs qui fournissaient l'insurrection déplaçaient la plus grande partie de l'héroïne qui entrait aux États-Unis, » dit le texte.
Parallèlement, en Amérique centrale, au moins un cinquième de la cocaïne qui entrait aux États-Unis, arrivait par le Honduras, où les militaires locaux, liés au trafic de drogue, étaient les pièces centrales du soutien secret de Washington aux Contras nicaraguayennes.
Ce schéma, c'est un Colombier au Pérou ou les alliances avec les forces armées, soi-disant anti drogues, on finit par financer des campagnes anti-insurrectionnelles dans lesquelles les principaux chefs n'étaient pas l'objectif, mais des alliés tactiques. Le cas de Vladimiro Montesinos, au Pérou, en est un bon exemple : chef du service du renseignement national, entraîné par la CIA, il a utilisé des ressources destinées à des opérations contre les drogues pour renforcer les réseaux de pouvoir et la répression intérieure. En 1996, un trafiquant a accusé Montesinos de recevoir des dizaines de milliers de dollars en pots-de-vin tandis que la police péruvienne ne saisissait qu'un seul chargement du cartel Lopez-Paredes avec 3 500 tonnes de cocaïne évaluées à 600 000 000 de dollars.
Il s'est passé la même chose au Mexique où la direction fédérale de la sécurité (DFS), créée avec le soutien des États-Unis, a remis des accréditations officielles à des chefs du trafic de drogue, que la DEA décrivait comme « une licence pour trafiquer. » Le cartel de Guadalajara, protégé par la DFS et son chef Miguel Nassar, Haro -un agent de la CIA- en est venu à être la clé de l'approvisionnement de l'insurrection nicaraguayenne financée par Washington.
Dans tous ces cas, les campagnes contre la drogue ont servi de couverture à des objectifs politiques et militaires, tandis que le trafic de drogue augmentait sous la protection officielle. Finance, politique et réseaux du BCCI.
Le cas de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) est, pour Scott, la preuve la plus claire de la façon dont la « guerre contre les drogues » s'est entrelacée avec des intérêts financiers, militaires et politiques au plus haut niveau. Cette Banque, qui a son siège au Pakistan et fait des opérations dans le monde entier, a été pendant des années un noeud central du blanchiment d'argent du trafic de drogue, de la vente d'armes et du financement d'opérations secrètes en Asie, en Amérique latine et en Asie occidentale.
L'investigation signale que le BCCI gérait les fonds du trafic de drogue afghan pendant la guerre contre l'URSS mais avait aussi des gens avec des Gouvernements alliés de Washington et des réseaux du renseignement comme la CIA et l'ISI pakistanais. Ouvre avec le plein soutien de l'ISI et la tolérance tacite de la CIA, Hekmatyar est devenu le principal trafiquant de drogue d'Afghanistan, » dit Scott à propos de Gulbuddin Hekmatyar, un dirigeant moudjahidin qui est devenu un grand patron de la drogue, renforcé politiquement et militairement grâce à ces structures financières.
Ce qui n'y ce qui signifie que, bien qu'en 1990, deux filiales de la BCCI, aient été déclarées coupables de blanchiment d'argent, et que plusieurs des membre de leur direction aient été emprisonnés, le département de la justice des États-Unis est intervenu pour freiner les enquêtes plus profondes. Entre 1988 et 1991, le département « a sollicité à plusieurs reprises que les actions du Sénat sur la BCCI soient retardées ou paralysées, a refusé de collaborer avec la sous-commission Kerry et, à certaines occasions, a fait des déclarations trompeuses sur l'état des investigations, » écrit l'auteur.
Le scandale a aussi touché des personnalités politiques de haut niveau. La BCCI et ses alliés financiers ont eu des liens avec des Gouvernements et des présidents comme Carter, Reagan, Busch et Clinton à travers des dons et des opérateurs comme le banquier Jackson Stephens.
Une guerre qui n'a jamais eu lieu
La révision des affaires présentées par Scott permet de conclure que la politique contre les drogues des États-Unis a été traversée par de profondes contradictions. Les preuves réunies montrent que les soi-disant efforts globaux contre les drogues ont fonctionné, dans la pratique, comme un instrument destiné à renforcer les intérêts stratégiques plutôt que pour freiner le pouvoir des cartels.
« La mal nommée « guerre contre les drogues », doit être remplacée par une campagne médicale et scientifique destinée à soigner la maladie des drogues, » dis Scott et il signale la distance entre le discours officiel et les résultats obtenus.
Tout cela, soutient la thèse que l'affrontement avec le trafic de drogue n'a jamais été véritable. Ce qui existe, c'est une gestion politique de la violence et du marché illégal dans lequel les alliés et les ennemis se redéfini par rapport au véritable intérêt stratégique. Les politiques des États-Unis renforcent ces réseaux criminels en les rendant plus complexes et résiliants. De cette façon, il est patent que la véritable priorité se situe dans l'instrumentalisation du trafic de drogue pour servir les buts de Washington.
Source: Bolivarinfos.over-blog